"La désinformation vise à fausser le jugement de l’homme afin d’égarer son jugement, sa décision et son action. Sa mise en œuvre soigneusement planifiée, mais parfois improvisée dans l’urgence de l’affrontement, repose sur une combinaison de procédés et de vecteurs orientés vers des cibles. Au regard de la théorie de l’information, la désinformation serait alors un mécanisme d’implantation et de développement de l’entropie ! On pourrait la comparer non pas à ces virus informatiques qui progressivement détruisent les données, mais à ceux qui modifieraient imperceptiblement les données initiales afin de fabriquer un leurre. L’agression par la désinformation consiste à fausser la compréhension d’une situation." François Géré
https://www.cairn.info/dictionnaire-de-la-desinformation--9782200257729-page-57.htm
La mission de la Society for Scholarly Publishing est de « promouvoir l'édition et la communication savantes, ainsi que le développement professionnel de ses membres par l'éducation, la collaboration et le réseautage ». The Scholarly Kitchen est un blog modéré et indépendant qui vise à remplir cette mission en rassemblant des opinions, des commentaires et des idées divergents et en les présentant ouvertement.
La Society for Scholarly Publishing a créé The Scholarly Kitchen en février 2008 pour :
- Tenir les membres du SSP et les parties intéressées informés des nouveaux développements dans le domaine de l'édition
- Indiquer les rapports et projets de recherche
- Interpréter l’importance des recherches pertinentes de manière équilibrée (ou parfois de manière provocatrice)
- Suggérez des domaines qui nécessitent davantage d'informations en identifiant les lacunes dans les connaissances
- Traduire les résultats d'activités connexes (publication en dehors de STM, commerce en ligne, tendances des utilisateurs)
- Attirer la communauté des experts en information STM intéressés par ces sujets et leur donner un lieu pour contribuer
David Crotty est rédacteur en chef de The Scholarly Kitchen et Angela Cochran est rédactrice adjointe. Dianndra Roberts est rédactrice adjointe chargée de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'accessibilité.
Les opinions exprimées sur Scholarly Kitchen sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas nécessairement celles de la Society for Scholarly Publishing ni celles de leurs employeurs respectifs.
https://scholarlykitchen.sspnet.org/about/Désinformation, mésinformation et communication scientifique
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2025/04/07/misinformation-disinformation-and-scholarly-communication-part-1/?informz=1&nbd=&nbd_source=informz
Article Libre d'Accès
(Cet essai est basé sur une présentation que j'ai donnée dans le cadre de la série OpenAthens Access Lab le 24 février 2025, intitulée « Désinformation, désinformation et confiance dans la communication scientifique : défis et stratégies ».)
L'essentiel d'abord : définitions
La « mésinformation » est généralement définie comme une « information fausse ou inexacte », tandis que le terme « désinformation » désigne généralement une désinformation délibérément utilisée pour induire en erreur.
La distinction entre ces deux catégories de fausses informations réside dans l'intention , ce qui la rend quelque peu complexe. Pour discerner la différence, il faut non seulement savoir si l'information est fausse, mais aussi quelle est l'intention de celui qui la diffuse, ce qui peut paraître facile, mais peut s'avérer plus complexe qu'on ne le pense.
De plus, parler de mésinformation ou de désinformation implique d'aborder la question de la vérité, ce qui semble mettre tout le monde mal à l'aise, y compris souvent ceux qui souhaitent se faire les gardiens de la désinformation.
Par exemple, l'année dernière, dans The Scholarly Kitchen , j'ai interviewé les dirigeants de l'American Sunlight Project , une organisation qui se consacre à « protéger la démocratie américaine contre la menace de la désinformation ». L'une de mes questions d'entretien portait sur la manière dont l'organisation gérerait les situations difficiles où les faits eux-mêmes sont contestés : resterait-elle silencieuse sur ces points ou suivrait-elle une stratégie particulière pour décider de son camp sur la question factuelle ? Ils ont répondu qu'ils n'avaient « aucun intérêt à arbitrer la vérité », ce qui me paraît fondamentalement incohérent, pour ne pas dire fallacieux : si votre objectif affiché est de lutter contre la désinformation, vous vous posez clairement en arbitre de la vérité. Prétendre lutter contre la désinformation tout en affirmant ne pas vouloir « arbitrer la vérité » revient à se prétendre pompier tout en affirmant ne pas vouloir faire la distinction entre les bâtiments en feu et ceux qui ne le sont pas.
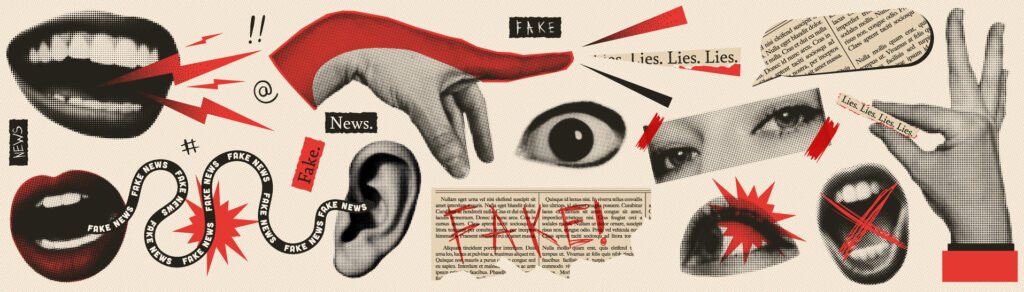
Depuis un an environ, certains ont suggéré l'existence d'une autre catégorie de mésinformation : la malinformation . Ce terme désigne une information techniquement vraie, mais sortie de son contexte ou présentée de manière partiale de manière à induire en erreur.
Et je voudrais suggérer un autre exemple : ce que j’appelle la désinformation et que certains ont appelé (d’après George Orwell) la « mémorisation » .
Il s’agit de dissimuler ou de supprimer délibérément des informations qui ont été, ou devraient être, rendues publiques, non pas parce qu’elles sont fausses, mais parce que ceux qui en ont la charge ne souhaitent tout simplement pas qu’elles soient rendues publiques ou parce qu’ils veulent dissimuler les preuves de leur publication passée.
Les gouvernements, les médias, les groupes de pression et les organisations politiques le font bien sûr régulièrement ; malheureusement, il arrive aussi que des universitaires et des chercheurs le fassent, parfois en affirmant publiquement que les recherches d’autrui n’existent pas , d’autres fois en refusant de rendre publics les résultats de leurs recherches par crainte que ces données puissent s’avérer utiles à leurs adversaires idéologiques, ou pour de nombreuses autres raisons.
Aux fins de cette discussion, j’utiliserai le terme « désinformation » de manière générique pour désigner tout ce qui précède, en faisant des distinctions plus fines lorsque le contexte l’exige.
Lutter contre la désinformation implique d'évaluer la véracité des faits. Prétendre lutter contre la désinformation sans « arbitrer la vérité » revient à se prétendre pompier sans faire la distinction entre les bâtiments en feu et ceux qui ne le sont pas.
Un autre point important à noter d'emblée : la désinformation est par définition une arme. On ne diffuse pas intentionnellement de fausses informations (ni ne supprime de vraies informations) sans une intention malveillante. On peut dire, et parfois croire, qu'on commet une légère atteinte à l'honnêteté et à l'intégrité intellectuelle au nom du bien commun, mais bien plus souvent, je crois qu'on peut raisonnablement supposer que les tentatives délibérées de tromperie découlent d'une volonté de nuire.
Hypothèses sous-jacentes
Une discussion significative sur la désinformation dans le discours scientifique repose nécessairement sur plusieurs hypothèses importantes :
- La vérité existe (sinon il n’y a pas de définition cohérente de la « désinformation »)
- La vérité n’est pas purement subjective (sinon il n’y a pas de définition cohérente de « fausseté »)
- Il est possible de discerner le vrai du faux (sinon, discuter de désinformation est inutile)
J'ajouterai deux hypothèses supplémentaires qui éclairent mon traitement de cette question, bien qu'aucune ne soit strictement et logiquement requise pour une discussion sur la désinformation ; toutes deux pourraient être appelées déclarations de croyance :
- La vérité compte en elle-même, indépendamment de sa valeur instrumentale (et peu importe qui la dit)
- Toutes les vérités et tous les mensonges n’ont pas la même portée
Si l'on part du principe que les hypothèses ci-dessus sont acquises, des questions cruciales se posent naturellement dans le contexte de la communication scientifique : comment distinguer le vrai du faux et le trompeur en science et en recherche ? Comment décider à quelles sources se fier – et dans quelle mesure devons-nous accorder une confiance implicite à une source d'information ? Dans le contexte des bibliothèques, comment concilier la nécessité de distinguer le vrai du faux et celle de présenter un large éventail de points de vue sur des questions controversées (sans parler de la nécessité de donner accès à des contenus erronés ou erronés à des fins pédagogiques) ? Dans le contexte de l'édition, comment naviguons-nous entre les opinions minoritaires légitimes et les travaux de recherche erronés ?
Ces questions ne sont ni simples ni faciles .
D’un côté, nous comprenons l’importance de faire confiance à la science ; de l’autre, il est évident depuis longtemps (et l’est devenu encore plus récemment ) que tout ce qui est présenté au monde comme « science » n’est pas digne de confiance.
D'un côté, l'un des moteurs fondamentaux du progrès scientifique est la remise en question réussie des idées reçues par des hypothèses minoritaires et émergentes ; de l'autre, les hypothèses émergentes ne sont souvent défendues que par une minorité d'universitaires ou de scientifiques, précisément parce qu'elles sont erronées.
D’un côté, l’écosystème de la communication scientifique a besoin de gardiens pour filtrer les absurdités et – ce qui est encore plus dangereux – les mensonges qui ne sont pas manifestement absurdes ; de l’autre côté, les gardiens sont des êtres humains avec des préjugés, des engagements idéologiques, des implications commerciales et d’autres intérêts qui peuvent entrer en conflit avec leur intérêt à évaluer de manière impartiale la validité des informations scientifiques.
La clé évidente pour surmonter ces difficultés réside dans une expertise pertinente combinée à une pensée et une analyse critiques honnêtes, essentielles non seulement pour distinguer le vrai du faux, mais aussi pour évaluer l'importance relative de ces deux vérités.
Le problème de la pensée critique, bien sûr, est d'abord qu'elle est difficile et exigeante, et ensuite que, lorsque nous nous y engageons honnêtement, elle ne nous conduit pas toujours à des conclusions qui nous conviennent ou qui nous conviennent, que ce soit sur le plan opérationnel ou idéologique. De nouvelles vérités (ou des vérités anciennes qui nous sont inconnues) peuvent avoir des conséquences perturbatrices sur nos processus et nos flux de travail, notre compréhension de nos disciplines, et même nos convictions sociales et politiques. La question que tout chercheur, scientifique, bibliothécaire et éditeur se pose est la suivante : suis-je prêt à accepter une vérité qui remet en question mes préjugés et mes préférences ? Puis-je évaluer ces informations d'une manière qui reflète ma fidélité à la vérité réelle plutôt qu'à ma compréhension privilégiée du monde ?
Différences fondamentales de mission entre les bibliothèques et les éditeurs
En matière de désinformation, il est important de reconnaître une différence significative entre la mission des bibliothèques et celle des éditeurs scientifiques. Pour les bibliothèques, donner accès à des informations vraies et fausses est fondamental ; pour les éditeurs, filtrer les fausses informations est fondamental. La première affirmation peut sembler contre-intuitive, mais à la réflexion, elle devrait être évidente : une bibliothèque de recherche ne peut soutenir l'étude des sciences politiques sans donner accès, par exemple, à des exemples de propagande de guerre trompeuse ou de fausses déclarations de politiciens ; elle ne peut soutenir l'étude de l'histoire religieuse sans collecter un large éventail de documents contenant des affirmations contradictoires sur des questions spirituelles ; elle ne peut soutenir l'étude de l'histoire économique sans fournir des exemples de théories économiques fausses et réfutées. Les bibliothèques de recherche existent non seulement pour donner accès à la vérité, mais aussi pour soutenir l'enseignement et la recherche, qui reposent tous deux non seulement sur l'accès à une information de qualité issue d'un large éventail de points de vue et de perspectives, mais aussi sur l'accès à des exemples instructifs de mensonges et de malhonnêteté.
L'objectif d'un éditeur scientifique est toutefois différent. Un éditeur de revue ou de livre cherche à acquérir et à publier des travaux scientifiques authentiques et fiables, et à filtrer les faux et les trompeurs. (C'est du moins le cas des éditeurs scientifiques légitimes ; il existe des éditeurs trompeurs qui prétendent produire des travaux scientifiques légitimes évalués par des pairs, mais qui publient en réalité tout ce qui leur est soumis, scientifique ou véridique ou non, à condition que l'auteur s'acquitte des frais de publication. Il ne s'agit pas de véritables éditeurs scientifiques et ils ne sont pas pris en compte dans cette discussion.) La fonction d'un éditeur scientifique est de soutenir l'enseignement et la recherche en donnant accès à la vérité, plutôt que de les soutenir en leur donnant accès à la fois à la vérité et à des mensonges pédagogiquement utiles.
PARTIE 2
" Le journalisme n’est qu’une prodigieuse entreprise de falsification, voire d’éradication de la réalité, sous couvert d’informer et d’analyser, l’information ne parlant en vérité que d’elle-même et l’analyse servant des intérêts propres à renforcer l’ignorance et la déchéance spirituelle des hommes. De là mon souci, qui irait croissant, de n’être plus informé. »"Richard Millet
Intégrité de la recherche et désinformation ; également, l'importance de l'humilité intellectuelle lors de la négociation de la différence entre désinformation et désaccord
Lorsque nous parlons d'« intégrité en recherche », nous parlons fondamentalement de véracité et de la distinction essentielle entre affirmations vraies et fausses.
Les chercheurs font preuve d'intégrité en menant et en rapportant leurs recherches de manière à accroître leur fiabilité et leur reflétant la réalité, en prenant des mesures telles que l'enregistrement de leurs essais ; la prise en compte des variables intermédiaires ; la formulation d'affirmations uniquement étayées par des preuves de haute qualité ; la mise à disposition de leurs données pour une évaluation indépendante ; etc.
Ces mesures et d'autres similaires ne sont pas importantes parce que la communauté des chercheurs et des scientifiques a simplement décidé de les reconnaître ; elles le sont parce qu'elles reflètent l'application des lois universelles de la logique et de la raison et augmentent la probabilité d'arriver à des conclusions objectivement vraies.
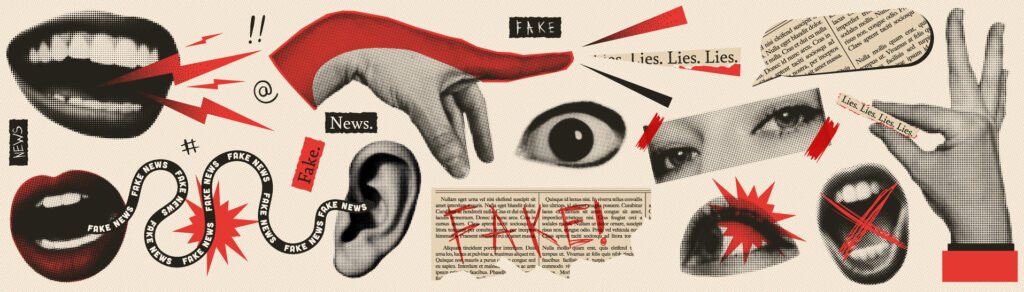
Maintenant, je m'attends à une objection ici – quelqu'un, je suppose, vient de lire le paragraphe ci-dessus et se dit quelque chose du genre : « Des lois universelles ? Objectivement vraies ? Allons. »
Mais soyons réalistes un instant. Aucun d'entre nous ne croit vraiment à l'inexistence de vérité objective, ni à l'absence de principes universels de logique et de raison applicables à sa recherche.
Par exemple, les lecteurs américains se souviendront sans doute d'un moment, lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, où l' on a prétendu qu'un réseau de trafic sexuel d'enfants était géré depuis une pizzeria de Washington. Affirmer qu'il n'y avait aucune vérité objective concernant cette affirmation – qu'elle n'était ni objectivement vraie ni objectivement fausse – serait absurde. (Et, bien sûr, prétendre que la vérité ou la fausseté de cette affirmation n'avait pas d'importance serait obscène.)
Le trafic avait lieu ou il n'avait pas lieu – et la seule façon d'établir la vérité ou la fausseté de l'affirmation était de faire appel à des preuves empiriques et d'en tirer des conclusions logiques.
Dans le cas de l'hypothèse du trafic sexuel au sous-sol, sa vérité ou sa fausseté pourrait être établie relativement simplement, en… enquêtant sur le sous-sol.
Pour d'autres hypothèses, bien sûr, établir leur vérité ou leur fausseté est plus complexe et difficile, et toutes ne peuvent être définitivement établies ou réfutées, que ce soit par la logique ou l'expérimentation. Mais cela ne signifie pas que ces hypothèses ne sont ni vraies ni fausses, ni que leur vérité ou leur fausseté n'a aucune importance.
L’un des objectifs fondamentaux de la communication scientifique est d’amplifier les affirmations appuyées par des preuves et un raisonnement solides, et de refuser d’amplifier celles qui ne le sont pas.
C'est évidemment là qu'interviennent les études et la science – et c'est pourquoi les concepts de mésinformation et de désinformation sont particulièrement complexes dans le contexte de la communication scientifique.
Malheureusement, il est devenu trop facile de qualifier des affirmations de « mésinformation » ou de « désinformation », non pas en se basant sur des preuves pour ou contre, mais plutôt sur l'évaluation des motivations de leurs auteurs – et sur le fait qu'elles favorisent ou non le discours scientifique, social ou politique de son choix.
Ce phénomène touche tout le spectre politique. Imaginez un homme politique qualifiant instinctivement de « fake news » tout article d'actualité qui ne correspond pas à ses intérêts et menaçant de poursuites judiciaires ou politiques les journalistes qui le diffusent. Pensez également au scientifique qui mène des recherches sur des questions médicales ou psychologiques controversées, puis occulte délibérément ses conclusions pour empêcher ceux avec qui il est en désaccord politique d'instrumentaliser ses données.
En réalité, il est impossible d'être un scientifique social ou appliqué sans s'efforcer d'établir la véracité des propositions scientifiques.
Si vous ne cherchez pas à déterminer ce qui est vrai ou non, et si vous ne prenez pas position (aussi contingente soit-elle) sur la base des preuves recueillies et évaluées, vous ne faites pas d'érudition ni de science.
De plus, l'un des objectifs fondamentaux de la publication scientifique est de promouvoir des affirmations dont la véracité est solidement étayée par des preuves et un raisonnement rigoureux, et de refuser de promouvoir celles qui ne le sont pas ; les scientifiques, les rédacteurs en chef et les éditeurs qui ne pratiquent pas de telles distinctions violent le contrat le plus fondamental qu'ils ont avec la société qui cautionne leurs travaux.
Nous ne saurons peut-être jamais tout ce qu'il y a à savoir sur le vrai et le faux dans le domaine, par exemple, de la génétique des populations, mais nous exigeons des généticiens qu'ils respectent les normes universelles de raison et de véracité objective : ils doivent mener leurs études avec rigueur logique et rendre compte de leurs résultats avec sincérité, nous permettant ainsi de mieux comprendre si les hypothèses testées sont vraies ou fausses. L’un des objectifs les plus fondamentaux de la bibliothéconomie est d’aider les étudiants à acquérir les outils intellectuels nécessaires à une recherche efficace d’informations et à une pensée critique – des activités et des compétences appliquées pour faire la distinction entre les affirmations vraies et fausses.
Désinformation, désaccord et humilité intellectuelle
Bien sûr, rien de tout cela ne nie que les conclusions savantes et scientifiques sur le vrai et le faux dépendent toujours du développement et de l'émergence de nouvelles preuves.
Et même si je tiens pour acquis que la vérité existe et peut être distinguée du mensonge, j'ai mentionné plus haut qu'il existe également des domaines de recherche importants dans lesquels il peut être impossible de déterminer la vérité absolue de manière scientifique ou strictement rationnelle.
De plus, même notre capacité à raisonner correctement à partir d'informations complètes et de qualité est limitée – et nous n'avons bien souvent d'autre choix que de raisonner au mieux à partir d'informations incomplètes ou douteuses. Et, bien sûr, il existe des domaines de recherche entiers dans lesquels des conclusions objectivement vraies sont tout simplement impossibles à obtenir, car elles reposent sur des valeurs : l'efficacité d'un médicament abortif est une question scientifique ; les règles (le cas échéant) que la société devrait imposer à l'avortement ne l'est pas.
Tout cela suggère que la frontière entre désinformation et désaccord n'est pas toujours claire, notamment dans le domaine de la communication scientifique.
Ceci, à son tour, souligne l'importance de l'humilité intellectuelle lors de l'évaluation (et de la caractérisation) du comportement et des motivations d'autrui : ceux qui confondent désaccord sincère et de principe avec désinformation propagent eux-mêmes des mensonges ; il s'agit de désinformation s'ils le font de bonne foi, et de désinformation s'ils le font intentionnellement.
Dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit que la désinformation n'est pas la seule arme utilisée – les accusations de désinformation le sont aussi souvent ; ces accusations sont facilement instrumentalisées par des personnes disposant d'un pouvoir économique, politique ou culturel pour réduire au silence ceux qui ne sont pas d'accord avec elles. Si vous pensez qu'une affirmation est fausse, il est très facile de la rejeter immédiatement comme de la désinformation (ou, pire, de la désinformation) – et si vous êtes en position de pouvoir, il est alors à la fois facile et tentant d'utiliser ce pouvoir pour étouffer ce avec quoi vous êtes en désaccord. Pensez aux politiciens qui crient « fake news ! » pour attiser le ressentiment contre ceux qui dénoncent leurs méfaits – ou, pire, qui utilisent les accusations de « désinformation » comme prétexte pour emprisonner leurs opposants .
Et pourtant, en même temps, il est certainement vrai que certaines propositions sont tout simplement fausses, et que certaines d’entre elles causent un tort énorme, et ceux qui ont le pouvoir de les contrer peuvent rendre au monde un immense service en agissant ainsi.
Dans ce contexte, que signifie « contrecarrer » ? Dans de rares cas, cela peut signifier à juste titre « supprimer » ; beaucoup plus souvent, cela signifie « s'engager avec ». La première approche est la censure (généralement une mauvaise idée, mais parfois justifiée ) ; la seconde est le débat (généralement une bonne idée, mais parfois une perte de temps).
Naviguer dans ces complexités est, malheureusement, une tâche pour laquelle la science elle-même ne peut pas nous être d'une grande aide. Pour y parvenir, il faut faire appel au raisonnement moral fondé sur les valeurs plutôt qu'au raisonnement scientifique fondé sur des preuves objectives.
Conclusion
En tant qu'universitaires, scientifiques, éditeurs et bibliothécaires, nous ne pouvons échapper à l'obligation de distinguer le vrai du faux.
Notre allégeance à la vérité est plus grande et plus profonde que notre allégeance à des programmes politiques ou à des courants de pensée sociale particuliers. Aucun programme, organisation ou mouvement qui exige notre malhonnêteté ne mérite notre loyauté.
Parce que la vérité est importante, éviter et dénoncer la désinformation est un effort louable et important.
Et parce que la vérité est importante, il est essentiel que nous poursuivions cet effort avec humilité intellectuelle, en reconnaissant qu'une vérité objective n'est pas possible à établir de manière égale dans tous les domaines, que notre propre capacité à distinguer la vérité de l'erreur sera toujours limitée et que nous serons toujours tentés de rejeter ou de combattre la vérité qui nous gêne socialement, politiquement ou professionnellement.
C'est un travail difficile, pas toujours gratifiant.
Parfois, c'est dangereux professionnellement et/ou socialement.
Mais c'est un travail dont le monde a besoin.
BRAVO , article instructif et remarquable
Commentaire
Faire la part du VRAI et du FAUX n'est pas toujours évident surtout à l'heure des réseaux sociaux qui propagent à la vitesse du son, n'importe quoi. Cet article est très intéressant , il montre que la science est de plus en plus en danger et que tout ce qui est colporté à droite et à gauche ne vaut pas grand chose avec l'étrange absence de cautions scientifiques. La science doit rester au centre de la médecine, mais quand on voit à l'oeuvre le responsable US de la santé , on est pris au dépourvu, c'est un cas d'école de désinformation et de malinformation. Quand on voit aussi qu'il ya de plus en plus de rétractation d'articles "scientifiques ", c'est plus qu'alarmant. Mais si on se situe au coeur de la science on est dans le droit chemin. Les patients par contre, tout au moins certains, ont leurs croyances médicales et là c'est quelque fois difficile de les convaincre de rejoindre la science la vraie et non la "pseudo science ". La malveillance est partout, la dystopie n'est pas loi,elle est trop proche . On peut dire et même crier Orwell est de retour et plus que ce que vous croyez.La vérité est ébranlée à tel point que certaines et certains arrivent à douter et ce de plus en plus même chez des esprits au départ cartésiens ! Les scientifiques , les médecins doivent rester dans la véracité, la "vraie vérité" et non pas dans les "contre vérités. Comme le souligne Rick Anderson "Notre allégeance à la vérité est plus grande et plus profonde que notre allégeance à des programmes politiques ou à des courants de pensée sociale particuliers, Aucun programme, organisation ou mouvement qui exige notre malhonnêteté ne mérite notre loyauté. Parce que la vérité est importante, éviter et dénoncer la désinformation est un effort louable et important." Il faudrait introduire dans les études médicales un module "vérité scientifique ou comment faire la part des choses entre le vrai et le faux de la sciance" Quelque fois les liens entre les deux son ténus et on peut facilement basculer d'un côté ou de l'autre de la vérité scientifique?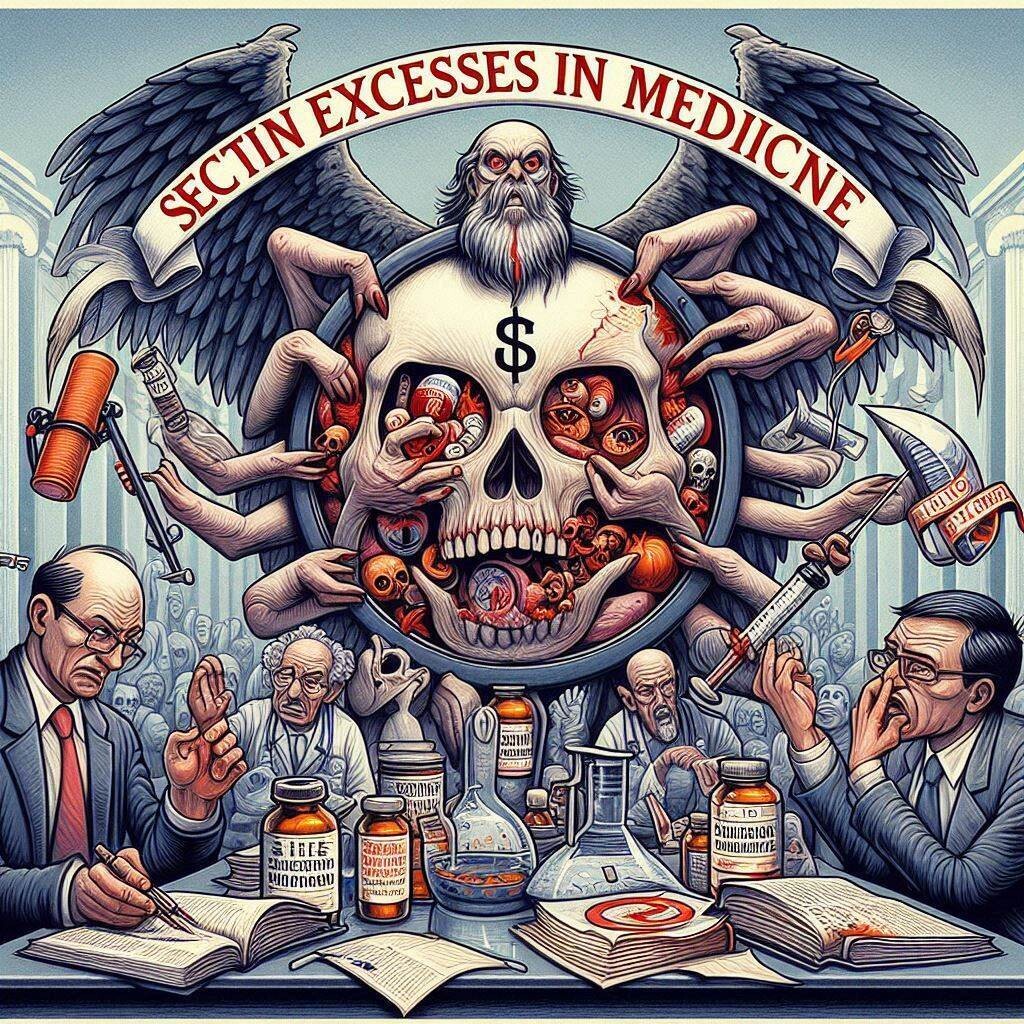
Etat des lieux en France rapport de la Miviludes / extraits

En 2024, la Miviludes (Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires) a reçu 4.571 saisines -soit 13,7% de plus qu'en 2021 et 111% de plus qu'en 2015. Sur tous les signalements reçus entre 2022 et 2024, la santé et le bien-être arrivent en tête (37%), devant les cultes et spiritualités (35%), selon le rapport d'activité de l'organisme publié mardi.
Son précédent bilan, dévoilé en 2022, pointait déjà la santé comme « sujet de préoccupation majeur ».
Alors que les malades du cancer restent les plus touchés par les dérives sectaires en santé, la Miviludes s'inquiète désormais du développement de pratiques de soins non conventionnelles (PSNC) au sein même d'établissements de santé.
Souvent considérées comme « douces », « complémentaires » voire « alternatives et finalement bénéfiques pour la santé », la grande majorité de ces pratiques « n'a pas été approuvée scientifiquement », souligne-t-elle.
Un grand nombre de signalements reçus par l'organisme, rattaché au ministère de l'Intérieur, dénoncent ainsi « la banalisation de ces pratiques au sein des établissements de santé », sans être nécessairement accompagnées de « mises en garde ou d'encadrement médical ».
La santé reste particulièrement touchée par les risques de dérives sectaires, et les pratiques de soins non conventionnelles, y compris dans des établissements de santé, sont une source de « préoccupation », souligne la Miviludes.
Ces méthodes discutables se retrouvent même dans certains hôpitaux publics
Ainsi les soins de support, notamment en cancérologie, « connaissent, à leur tour, des dérives à caractère sectaire », détaille le rapport.
« Aujourd'hui, il est courant de trouver des séances de Reiki, de magnétisme ou encore de ‘bol tibétain’ dans les établissements publics de santé », décrit la Miviludes.
Le risque principal repose sur « la prétention de certains pseudothérapeutes à substituer les PSNC à la médecine conventionnelle, excluant totalement le recours à celle-ci », précise l'institution.
En 2024, la Miviludes a adressé 45 signalements au parquet -contre 20 en 2021-, fréquemment « sur des conseils ou pseudo-soins donnés à des ’patients’ (...) par des pseudothérapeutes n'ayant pas de diplôme reconnu par l'État ».
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/reiki-magnetisme-ou-bol-tibetain-lhopital-la-miviludes-tire-la-sonnette-dalarme
LE RAPPORT MILIVUDES 2024/2025
https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/sites/default/files/MIVILUDES-RAPPORT-24-web.pdf
Toutes ces dérives sont dans le faux, avec l'absence total de science . Les pseudos exercices en médecine paralléle prolifèrent , Le manque de médecin est une aubaine pour les naturopathes, les étiopathes, les ostéopathes, les kinésiologues les magnétiseurs, les buveurs d'urine etc....................ils vont bientôt être plus nombreux que les médecins de famille, mais où est la science ? Que devient la science ? Et les patients , ils sont dans l'erreur, et il faut leur dire, leur expliquer encore et encore !
C'est notre rôle de MEDECIN, nous devons protéger les patients, même contre eux-mêmes !
Copyright : Dr Jean Pierre Laroche /2025


